Vers une culture visuelle révolutionnaire
Les pédagogies alternatives, l’Éducation nouvelle, la pédagogie institutionnelle ou encore la pédagogie radicale connaissent, ces dernières années, un regain d’intérêt notamment chez les jeunes artistes et commissaires d’exposition. Cette vitalité heuristique nécessite cependant d’être prudent·e quant au risque d’une catégorisation d’un sujet, d’un thème qui homogénéiserait ce qui souhaite et demande à être singulariser. En effet, tout semble concourir à rapprocher et assembler en quelque sorte deux « pères » de ce mouvement, Paulo Freire et Célestin Freinet. Or de nombreux points diffèrent dans leur conception et leur engagement politique. Baptiste Jacomino a pris soin de différencier hier en opérant une analyse comparative entre Maria de Montessouri et Célestin Freinet, deux figures de l’Éducation nouvelle, un mouvement européen né dans l’après-Première Guerre mondiale.
Loin de nous engager ici dans une analyse comparative, revenons précisément à ce que soulève le courant autogestionnaire (et non institutionnel cf. la pédagogie Freinet) d’une certaine pédagogie qualifiée de radicale et attachons-nous à (re)nommer les enjeux. Ceci avant d’observer ce qu’elle a pu produire au cœur de deux projets artistiques de culture visuelle révolutionnaire présents sur la côte Ouest des États-Unis entre 1967 et 1977.
Pédagogie et conscientisation
Les principes de la pédagogie de Paulo Freire proviennent du postulat selon lequel l’opprimé·e n’est pas uniquement un·e victime, mais qu’elle ou il est un sujet historique qui peut transformer la société, non pas tant par des actes de rébellion qu’à partir d’une pratique collective alternative qui génère à son tour une autre culture, un autre imaginaire 1 .
La méthodologie d’alphabétisation pour adultes – nous nous situons donc dans le registre de l’éducation populaire 2 - de Freire suppose une pédagogie émancipatrice nourrie de l'observation des séquelles de la colonisation espagnole et portugaise en Amérique latine. Les relations inégalitaires entre les grands propriétaires terriens et les paysans ont laissé des traces dans la société brésilienne. Les indigènes réduits pendant plusieurs siècles au silence ont fini par accepter tacitement cette « domination 3 », créant ainsi une conscience du ou de la « dominé·e ». La langue et le système de valeurs des dominant·e·s ainsi que leurs « mythes » ont été assimilés par les paysans. « L'aliénation culturelle » s'est accompagnée d'une « aliénation politique » : le système de valeurs des paysans s'est adapté pour justifier, et donc perpétuer, le statu quo. Les dominée·s ne sont plus capables de prendre conscience de leur situation. Ceci correspond au premier niveau de conscience des opprimé·e·s, un premier stade décrit par Freire comme « conscience magique » : l'individu s'adapte de façon passive et défensive à la situation, sans pouvoir se rendre compte des contradictions socio-économiques de la société. Elle, il est silencieux et docile. Le second stade, dit de « conscience naïve », correspond à un début de prise de conscience du problème sans connexion avec les problèmes structurels de la société. Les problèmes sont individualisés, et par conséquent, perçus comme des accidents. Dans ces deux cas, l'individu n'a aucune vision globale des fondements structurels des inégalités. La pédagogie libératrice intervient comme médiatrice pour déjouer dans ces premiers temps la reproduction d’un schéma d’oppression dont les différentes étape s avaient été, au préalable, analysées par le psychiatre Frantz Fanon dans les Damnés de la terre 4 .
Le psychiatre réunionnais, Frantz Fanon, a observé les effets de la colonisation sur les colonisé·e·s depuis le point de vue de la névrose et du ou de la traumatisé·e. Il expliquait, selon le principe classique de la psychologie, que trois générations de traumatisé·e·s suffisaient à créer une interpellation qui les conduise à la lutte armée. Grâce à cet argument, Fanon justifie ce qui peut paraître injustifiable : le recours systématique à la violence par les colonisé·e·s, fondé sur le simple principe du « retour de bâton ». Fanon considère cette forme de violence comme juste puisqu’elle se retourne contre une forme de violence première, celle du colonisateur. Dans ce sens, le SCUM Manifesto 5 de la féministe Valerie Solanas rejoint le geste radical de Fanon en proposant l’insurrection d’une communauté de femmes contre une communauté d’hommes. Mais si Freire s’inspire de Fanon en ce qui concerne les modalités complexes et graduelles d’intériorisation de l’oppression et de la domination, il propose de remplacer la lutte armée par la production du savoir et de culture émancipateurs. Nous retrouverons cette orientation de Freire au cœur du Project Other Ways et du Women’s Building :
La grande question est de savoir comment les opprimés, qui “accueillent” en eux l’oppresseur pourront contribuer à la naissance de leur propre pédagogie libératrice. Mais cela est impossible tant qu’ils vivent dans la pensée qu’être, c’est ressembler à l’oppresseur. La pédagogie des opprimés, qui ne peut être élaborée par des oppresseurs, est un des instruments d’une découverte critique, celle des opprimés qui doivent comprendre que, comme les oppresseurs, ils sont eux aussi en proie à la déshumanisation 6 .
Selon Freire, l'éducation traditionnelle, telle qu’elle est instituée, délégitime la culture des paysans opprimés à leurs propres yeux en leur montrant par comparaison leur ignorance d'un certain savoir érigé comme seul savoir légitime. D’après le modèle classique, le savoir est prodigué de manière verticale et autoritaire « bancaire » contre lequel Freire élabore puis théorise sa méthode :
À l’opposé de l’éducation “bancaire”, l’éducation conscientisante, répondant à l’essence de la conscience qui est son intentionalité, refuse les communiqués et donne vie à la communication. 7
Dans ce cas, le professeur est le seul dépositaire du savoir légitime et l'impose à ses élèves. À l’opposé de cette transmission classique, Freire cherche à considérer l'opprimé·e comme sujet capable de transcender et de recréer le monde en toute autonomie. En effet, selon le pédagogue décolonial, pourrait-on écrire, personne ne naît sans culture puisque celle-ci est créée par l'Homme. L'action est alors le résultat de la praxis permettant à l'Homme de devenir sujet, et par là plus humain :
Confondre subjectivité avec subjectivisme ou psychologisme, et nier l’importance que la première doit avoir dans le processus de transformation du monde et de l’histoire, c’est tomber dans un simplisme ingénu. C’est admettre l’impossible, un monde sans hommes, et cela équivaut à l’autre naïveté, celle du subjectivisme pour lequel il existe des hommes sans monde 8 .
L'éducation des opprimé·e·s doit naître de leur propre initiative et non s'imposer à eux, afin de leur permettre de prendre conscience d'eux-mêmes, de leur possibilité d'action sur leur environnement . Il s'agit dès lors d'apprendre à l'Homme à se libérer lui-même, à s'affranchir de la colonisation de l'esprit en proposant une conception humaniste et libératrice de l'éducation. Dans ce sens, Paulo Freire s’inscrit dans la lignée de la philosophie existentialiste. L'alphabétisation apparaît ainsi comme un acte éminemment politique puisque l'analphabétisme est le résultat d'une négation du droit à l'expression des paysans. Apprendre à lire marque une étape vers la pleine participation de l'Homme à la vie de la société, ou tout du moins à la vie d’une société lettrée. Ces professeurs d'un nouveau type ne sont plus des transmetteurs de savoir, des experts, mais des individus qui apprennent eux aussi, en inter-relation avec les alphabétisant·e·s :
" Au contraire, l’éducation conscientisante ne distingue pas ces deux moments dans l’action de l’éducateur- élève. Celui-ci n’est pas d’abord un sujet connaissant, puis un sujet qui raconte ce qu’il sait. Il est toujours un sujet connaissant, à la fois quand il prépare ses cours et quand il rencontre ses élèves dans le dialogue " 9 .
Ce n’est qu’au dernier stade de conscience, la « conscience critique », que les opprimé·e·s peuvent aboutir à une analyse de la réalité et de ses contradictions. La méthode proposée par Paulo Freire a été confirmée par une série d'expériences répétées pendant plus de vingt ans dans des régions rurales et urbaines d'Amérique du Sud. Celle-ci repose sur la nécessité d'axer l'enseignement sur les problèmes et la réalité des analphabètes pour leur apprendre à regagner leur pouvoir d'expression grâce à leur expérience. Il s'agit donc d'organiser la population en groupes, en cercles culturels, tout comme le consciousness raising du Women’s Liberation, et de discuter avec elle de sa réalité, d'analyser les conditions locales et même d'élaborer des projets qui lui permette d'agir sur cette réalité. Concrètement, le travail commence par des entretiens permettant à l'animateur de connaître la réalité des alphabétisant.e.s et leur univers linguistique de base. Ces premières réunions rendent possible la sélection de « mots générateurs » choisis par l'animateur pour leur richesse phonétique. Grâce à la décomposition des syllabes puis à leur recombinaison, d'autres mots peuvent être trouvés. Ces mots générateurs ont aussi une capacité à évoquer le contexte social, et donc à éveiller la conscience, puisqu’ils sont codifiés, c'est-à-dire représentés graphiquement sur des diapositives ou des panneaux. Les participants cherchent alors à dé-codifier la situation existentielle représentée, ce qui permet ainsi de manifester la capacité de chacun des membres du groupe à communiquer et à agir. Ce décodage est le fruit du dialogue des alphabétisant.e.s entre eux, l'animateur se bornant à susciter des problèmes sous forme de questions, ce qui permet au groupe de dépasser une lecture naïve de la réalité :
" En face d’une situation codée (tableau dessiné ou photographie qui renvoie, par abstraction, au concret de la réalité existentielle), les individus ont tendance à réaliser une sorte de “scission”, dans l’opération de décodage, qui correspond à l’étage que nous appelons “description de la situation”. La scission permet de découvrir l’interaction entre les parties de l’ensemble scindé. Cet ensemble que constitue la situation codée décrite, et qui auparavant avait été perçu d’une manière diffuse, commence à prendre une signification à mesure qu’il subit la “scission” et que la pensée revient à lui en considérant les éléments qui résultent de la scission " 10 .
Les alphabétisant·e·s découvrent alors leur place dans la société, leur pouvoir de transformer leur situation, et la nécessité de savoir lire et écrire leur apparaît du même coup. La pédagogie de l’émancipation de Freire se propage sur le continent nord-américain dès la fin des années soixante, au cœur du mouvement du Free Speech qui se développe sur les campus nord-américains. Elle insuffle l’idée de penser autrement la production des savoirs et la création de culture à partir de petits groupes mettant en avant le principe de différence ou d’oppression comme légitime pour élaborer certains savoirs, cultures et imaginaires qui nuanceraient la prégnance de certains régimes de visibilité.
Très proche des féministes africaines-américaines (comme en témoigne par exemple bell hooks 11 ), Paulo Freire a ouvert, ensuite, au genre et à la race sa grille marxiste jusqu’alors essentiellement tournée vers la classe sociale :
" Plus les élèves prennent conscience du fait qu’ils sont des êtres situés dans le monde et avec le monde, plus ils se sentiront mis au défi et plus ils seront obligés de donner une réponse. Défiés, ils comprennent le défi dans leur propre démarche pour l’affronter. Mais précisément parce qu’ils affrontent le défi comme un problème lié à d’autres problèmes, dans une optique globale, et non comme quelque chose de pétrifié, la compréhension qui en résulte tend à devenir progressivement critique, et donc de plus en plus désaliénée. Celle-ci facilite la compréhension de nouveaux défis qui apparaissent au fur et à mesure des réponses, et grâce à elle ils se découvrent de plus en plus engagés. C’est ainsi que peu à peu la compréhension engage " 12 .
Extrait https://www.innovation-pedagogique.fr/article1644.html
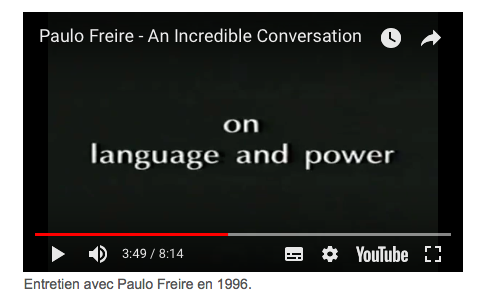
La pédagogie d’ Other Ways par Allan Kaprow et Herbert Khol au cœur d’un contexte contre-culturel
À la veille de la publication de l’ouvrage, The Making of Counter Culture 13 , qui conceptualisa la contre-culture nord-américaine et permit sa large diffusion, Allan Kaprow rédigea soigneusement la présentation du projet collaboratif Other Ways. L’argumentation serrée des différentes versions du programme éducatif et artistique témoigne de l’intérêt passionné d’Allan Kaprow pour la pédagogie. « Le titre de ce projet en cours », écrit-il, « insinue une approche pluraliste de l'éducation : aucune façon n'est en soi correcte, il y a toujours d'autres chemins 14 . » Kaprow convaincu souhaitait démontrer à quel point le happening comme forme d’art révolutionnerait le bien commun de l’éducation :
« Comme un art exclusivement social, les happenings marquent une tendance en expansion dans les arts, loin de la tradition intellectuelle de l'aliénation, et vers des relations interpersonnelles. Qui plus est, le happening déjà réputé, offre une méthode - qui est un jeu - pour des étudiants récemment engagés dans une formation traditionnelle 15 . »
Les sources du projet Other Ways
Ce souci de réforme de l’éducation par le jeu a débuté bien en amont des premiers happenings d’Allan Kaprow. Au cours de leurs années de formation, George Brecht, Bob Watters et leur camarade Allan Kaprow évoquaient avec passion l'enseignement innovant de John Cage 16 et de ses nombreuses applications. Les sessions pédagogiques conçues à partir de jeux improvisés se substituaient à un apprentissage répétitif, laborieux en adhésion avec les principes d’un maître. Selon les étudiants, les formes d’haïku pédagogique proposées par le compositeur John Cage permettaient d’impulser une transmission plus créative, collaborative et joyeuse. Dans les cours du compositeur, la théorie et l’histoire de la musique se retira au profit d’une poésie expérimentale imprégnée de philosophie boudhiste-zen. La « méthode » du happening telle que Kaprow l’invoque dans son texte de présentation, adhère à l’esprit cagien lui-même porteur d’une inlassable quête philosophique depuis le terrain de l’expérimentation, de la transversalité des sujets abordés et de l’activation sensible des spectateurs/participants. « Ceux qui font, savent 17 » aimait à rappeler un autre père intellectuel d’Allan Kaprow et grand visionnaire des nobles relations entre pédagogie et art : John Dewey. Par ailleurs, ce changement de paradigme en art qui consiste en l’adhésion collective des étudiants de John Cage et de Cage lui-même, à la gratuité d’un faire, d’un jeu artistique, ne pourrait être tout à fait compris sans un retour sur l’héritage transmis par Marcel Duchamp.
Allan Kaprow revenait en 1973 18 sur les raisons de son admiration pour le dadaïste français et précisait en quoi celui-ci avait préfiguré l’ un-artist 19 . Le terme un-artist apparut dans une série de trois essais intitulés The Education of the Un-Artist publiés entre 1969 et 1974. L’expérience pionnière de Other Ways dédiée à une refonte de la pratique scolaire par la méthode du happening, a grandement inspiré la rédaction du Part I, le premier essai. Jeff Kelley rappelle que selon Kaprow, les artistes se retrouvaient dans une situation délicate après la Deuxième Guerre mondiale car les conséquences idéologiques et humaines horrifiantes les faisaient douter de tout, y compris de la définition même de l’art. Sur ce point, Marcel Duchamp représentait, selon Kaprow, le prototype même de l’ un-artist. Libre de mener la vie qu’il souhaitait loin de la représentation de l’artiste-martyre, Marcel Duchamp questionnait l'idée même de l'art. Ses attitudes perçues comme européennes - son dandysme, le désintérêt en apparence des contingences de la vie, l’indifférence quant au facteur de fatigue et de sueur lors de la production du travail - et ses gestes artistiques - le ready-made, le secret, l’effacement, la suspension du jugement de goût - bousculaient les codes de reconnaissance validant ou invalidant ce qui fait art et qui le fait. Ainsi Allan Kaprow confie-t-il : « George Brecht, Bob Watters et moi-même étions ébahis par l’effet libératoire de douter de l’entière idée de l’art 20 . » Qui plus est, selon Allan Kaprow, l’ un-artist était porteur d’une fiction qui génèrerait une mythologie personnelle à l’instar de celle de Marcel Duchamp: « Voilà comment je le nomme aujourd’hui maintenant en 1973. Je m’invente mon Marcel Duchamp : c’est ma fiction, après tout si Duchamp nous intéresse c’est que nous avons tous notre propre fiction 21 . »
Ce double effet libératoire à l’égard d’un positionnement ontologique et historiographique sur l’art implique une restauration des liens entre art, expérience et vie quotidienne qui demeuraient jusque-là atrophiés. C’est précisément à cette jonction que se retrouvent les filiations cardinales (John Dewey, Marcel Duchamp et John Cage) de l’initiateur du Other Ways Project. L’ un-artist devait rompre avec le principe moderniste de l’art comme discipline autonome et isolée et l’aventure Other Ways s’y appliquait. Jouer et imiter allaient devenir des ressorts salvateurs pour l’art et la pédagogie. Leurs contours n’allaient cesser de se préciser au fur et à mesure des trois essais sur l’éducation de l’ un-artist mais avec constance ils déjouèrent le spectre d’une certaine littéralité de l’imitation au profit d’une affinité forte pour les formes mimétiques déjà existantes : « Dans cette ‘ressemblance à la vie,’ Kaprow devine un ‘happening cosmique’ dans lequel toutes les choses imitent toutes les autres : les plans de ville sont comme des systèmes circulatoires, les ordinateurs font allusion au cerveau, les jeux scénarisés des enfant singent les comportements des adultes 22 . »
Pour l’ un-artist, la tâche répétée consistait à copier en jouant à imiter ; la salle de classe devenait un terrain de recherche privilégié.
SUPPOSE, you used graffiti as a text book
Après les vaines tentatives initiées par Allan Kaprow auprès des écoles et des universités de New York, Other Ways Project reçut un soutien financier conséquent de la part de la Carnegie Corporation de New York. Celle-ci était commanditaire du projet et à l’origine de la composition du binôme composé par Allan Kaprow, nommé pour les besoins de l’organigramme « artiste-enseignant », et Herbert Khol « écrivain-enseignant 23 ». Grâce au réseau professionnel de Khol, Other Ways Project a pris ancrage dans la California Public School System, située dans la Bay Area et ce 5 jours sur 7, pendant une année scolaire de septembre 1968 à juin 1969. Une à deux fois par semaine, à l’initiative des co-directeurs, différents workshops étaient programmés. Khol aimait à rappeler que le contexte contre-culturel de la Californie offrait un écrin favorable à l’avènement d’une discipline nouvelle : la pédagogie radicale 24 . Le temps de cette année scolaire, Other Ways Project s’était engagé à mettre les arts contemporains et les artistes vivants au cœur d’une éducation publique. Le propre de cette expérimentation n’était pas seulement d’encourager les talents artistiques des enseignants et de leurs étudiants auprès de différentes disciplines mais, plus important, de favoriser les processus basiques de l’imagination familiers aux peintres, aux compositeurs, aux danseurs, aux réalisateurs, aux poètes etc., auprès d’enfants et d’instituteurs de l’école primaire .
Une autre des caractéristiques du projet Other Ways était que le processus artistique fût envisagé pour ses vertus organiques à partir desquelles on prenait du plaisir. Les directeurs du projet étaient intimement convaincus que l’apprentissage pouvait bénéficier de l’imagination et de l’auto-réalisation de soi plutôt que de la compétition pour les diplômes et de la spécialisation des compétences. Dans ce sens, la campagne d’appel à participation, nommée SUPPOSE, reflétait toute l’ambition du Other Ways. Dans plusieurs halls d’écoles primaires, on pouvait découvrir l’image énigmatique du poster d’une salle de classe vidée des élèves et de l’enseignant associée à l’adresse directe tout aussi mystérieuse qui appelait à l’action : SUPPOSE. Les sous-titres donnèrent quelques indications comme : « SUPPOSE que tu utilises les graffitis comme un texte », « SUPPOSE que tu ne puisses pas écrire et que tu ne puisses que prendre des photos », « SUPPOSE que tu doives faire de la musique seulement avec un élastique 25 ». Le passage aux verbes directes dans les partitions de Kaprow annonçait l’incarnation des vertus de l’éducation de l’ un-artist. La subversion de l’école était en marche sous la tutelle des pères kaprowiens : John Dewey, Marcel Duchamp et John Cage. La dimension révolutionnaire d’ Other Ways en faisait un étendard émancipateur à la fin des années soixante : « En un sens, nous étions des pionniers, aidant à faire un monde nouveau et plus juste en travaillant avec les enfants, et particulièrement les enfants des pauvres 26 . »
Local Communities
L’autre principe important sur lequel Kaprow et Khol s’engageaient devant la Carnagie Foundation, concernait l’implication des artistes auprès de tous les groupes sociaux ( local communities) de la Bay Area. Plusieurs personnes dont les artistes, Kaprow y compris, avaient été recrutés en dehors de ces groupes sociaux ; néanmoins, l’intérêt pour « l’environnement réel » et ses « habitants » 27 , en grande partie black-americans et hispaniques, était primordial. La Carnagie Foundation soucieuse d’une redistribution sociale et culturelle avait sûrement pris pour modèle, un autre programme pédagogique et artistique sans précédent impulsé par l’artiste assemblagiste Noah Purifoy.
En effet, en août 1965, le jeune artiste Noah Purifoy avait assisté aux émeutes violentes de Watts, Californie du sud, en compagnie de ses étudiants en art. Face à cette déferlante violente d’injustice et d’impartialité, Purifoy avait ressenti la nécessité de récolter les débris de tissus et de verre laissés par l’affrontement entre les habitants noirs du quartier de Watts et les policiers blancs. L’artiste avait voulu croire au potentiel rédempteur, au sens deweyen 28 , d’une telle pratique artistique. Les cours dispensés au Watts Art Center avaient peu à voir avec une essence de l’art, une histoire de l’art ou encore des formes esthétiques. L’enjeu de l’enseignement de Purifoy avait été davantage collectif et social qu’ontologique, un positionnement qui présente ici encore des affinités avec ce qui a été évoqué précédemment. Purifoy se souciait des images que chacun·e se faisait de son environnement et de leur articulation et, proposait d’envisager comment ces images pouvaient coexister collectivement. Sur le même principe que les mots-générateurs de Paolo Freire détaillés dans Pédagogie des opprimés 29 , Noah Purifoy avait encouragé ses élèves à construire leurs propres représentations d’un monde révolutionnaire. Il avait établi un lien entre un art de nommer puis d’assembler et la modélisation d’un imaginaire d’émancipé·e·s. Grâce aux pratiques de ce que Noah Purifoy 30 avait théorisé, pour la première fois, en 1967, sous le nom de Junk Art ; les habitués du Watts Center avaient expérimenté le potentiel de transformation de soi avec les autres grâce aux nouvelles images et nouveaux types de savoir qu’elles catalysent : « Nous croyions que l’expérience de l’art était transposable à n’importe quel autre domaine de leurs activités [quotidiennes] et s’ils partageaient avec nous à Watts une bonne expérience, positive, ils pouvaient repartir forts de cet enseignement […] à l’école ou autre […] Nous essayions d’expérimenter comment cela était possible, comment relier le processus de l’art avec l’existence 31 . »
En lisant le récit posthume de l’aventure Other Ways 32 narré par Allan Kaprow, on s’aperçoit à quel point, trois ans plus tard, sur la côte californienne, les intentions radicales étaient similaires à celles de Noah Purifoy et ce dans un même contexte d’ostracisme racial puissant. Vingt ans après cette expérience, Kaprow témoignait avec fierté de l’engagement du Other Ways Project auprès des enfants, le plus souvent blacks et hispaniques, scolarisés mais relayés aux marges des savoirs par l’institution éducative car considérés comme des illettrés par leurs instituteurs.
Les quatre lettres
Dès les premières semaines du Other Ways Project, Kaprow décida de distribuer à chaque enfant des appareils photographiques bon marché et autant de pellicules que nécessaire. À l’occasion d’une des marches aux alentours du local-vitrine - concédé par l’école et qui donnait à Other Ways une ouverture sur la rue et l’espace public à l’opposé de ce que l’espace fermé de la classe représentait -, Kaprow les invitait à prendre en photo tout ce qui pouvait retenir leur attention. D'une part, ils se photographiaient les uns et les autres. Leurs ombres se mêlaient à celles des hélicoptères en vol et aux silhouettes des chars de l'armée. En effet, la répression du printemps 69 à Berkeley menée par le gouverneur Ronald Reagan était omniprésente rappelle Kaprow. D’autre part, les élèves de cette nouvelle école buissonnière accordaient beaucoup d’attention aux graffitis. Or Kaprow avait été interpellé par cette fascination des plus jeunes pour les slogans et les noms propres qui recouvraient les murs des rues car s’ils étaient vraiment illettrés comment pouvaient-ils déchiffrer leurs sonorités. Pour accentuer leur curiosité quant à des inscriptions à connotation sexuelle, Kaprow les encourageait à visiter les toilettes publiques. Il permit aux filles se rendre dans les toilettes des garçons puis les garçons dans les toilettes des filles afin d’y prendre davantage de photos. Il était manifeste que les élèves du primaire lisaient et comprenaient ce qu’Allan Kaprow nomme pudiquement dans son témoignage les « 4 lettres 33 ». Il s’engagea aux côtés d’Herbert Khol dans la valorisation d’un enseignement de la lecture et de l’écriture hors-norme, inspirée de la pratique des happenings, des intentions évoquées dans l’ un-artist et de la révolution contre-culturelle des savoirs.
Puis, Herbert Kohl et Allan Kaprow recouvrèrent de papier craft leur espace-vitrine Other Ways et demandèrent aux élèves de rapporter toutes leurs photos, de les accrocher, de les peindre, de faire des dessins. Ensuite, les jeunes enfants s’amusaient à établir collectivement des liens à l’instar de la méthode de Noah Purifoy. Des noms propres comme celui de Bobby Huey - membre actif du Black Panthers, alors emprisonné -, de Hugo Chavez alors à la tête de la Révolution bolivarienne ou de Bobo, un leader de gang latino se détachèrent de l’agencement image-mot. Les jours suivants, les élèves racontèrent des histoires réelles et fictives qui se mêlèrent au pêle-mêle de graffitis photographiés. Allan Kaprow et Herbert Khol récupèrent alors d'anciens manuels d’apprentissage de lecture Dick and Jane devenus récemment obsolètes mais qui portaient en eux les marques d’une société patriarcale et blanche. Ils demandèrent aux élèves de refaire les illustrations. Beaucoup d’illustrations étaient découpées et remplacées par des dessins, Dick and Jane étaient par exemple transformés en monstres avec des variations de couleur de cheveux des plus étonnantes. Les textes étaient refrappés avec une dimension ironique pertinente. Fiers de cette expérience, Kaprow et Khol décidèrent d’exposer les manuels revus et corrigés dans un esprit Other Ways Project dans leur local-vitrine. L’alternative éducative a été un franc succès. Les élèves en passe d’exclusion réintégrèrent le cursus scolaire classique. L’éducation de l’ un-artist par le recours aux jeux avait donc remis en question l’évaluation définitive de certains enseignants quant à un illettrisme ferme et définitif d’enfants marginalisés au sein-même de la classe.
Relayer les formes contre-culturelles à l’école
Fort de cette implication auprès des local communauties, Kaprow et Khol lancèrent des éditions afin de relayer des littératures et cultures communautaires à savoir black-américaine et moins connue, nuyorican. Le poète Victor Cruz, un des acteurs culturels reconnus du mouvement nuyorican, avait été associé au Other Ways Project dans le cadre d’ateliers d’écriture. Il y porta les valeurs émancipatrices des poètes, musiciens, intellectuels puerto-ricains qui subissaient les insultes et discriminations liées à leur parcours migratoire et à leur couleur de peau. Sur le modèle du mot d’ordre Black is Beautiful - propre à une culture politique de la communauté black qui s’émancipait entre autres de la rigueur pastorale du militant des droits civiques Martin Luther King -, Cruz distillait avec fierté les ferments d’une différence culturelle flamboyante qui brillait par un désir de paraître pour exister intimement et collectivement. Parrainé par Allen Ginsberg - poète ouvertement homosexuel -, Cruz incarnait la filiation entre la contre-culturelle beat generation très influencée par les dadaïstes 34 et l’avènement des mouvements d’émancipation des communautés en prise avec les effets de répétition d’une culture de la blanchitude 35 . Ces collaborations remirent en cause l’esprit cagien qui se plaisait à répéter dans ses différentes conférences et publications « Pourquoi changer le monde, cela pourrait être pire ». Jeff Kelley rattache notamment le refus de l’engagement politique de nombre des artistes américains des années cinquante au climat délétère de chasse aux sorcières opérée par la politique de McCarthy 36 . Pourtant, a contrario des positions politiques d’une des figures de proue de l’avant-garde nord-américaine de la côte Est, lui-aussi homosexuel – John Cage - ; sur la côte Ouest, le poète Allen Ginsberg était remarqué, loué par les plus jeunes pour ses positions publiques risquées au regard d’une expression artistique muselée. Le vent beat 37 a, qui plus est, largement contribué à l’émergence des pratiques assemblagistes - qui réunissent Noah Purifoy et Allan Kaprow - et à l’idéalisme du Other Ways Project en miroir avec les luttes qui se déroulaient à Berkeley en 1969. Au cœur de cette histoire pédagogique radicale étonnante, les collaborations de Mike Spino et Sim Van der Ryn avec Allan Kaprow et Herbert Khol participèrent au renouveau beat et soufflèrent le modernisme hippie.
Mike Spino était un coureur athlétique de renommé internationale. Il est resté célèbre pour avoir été le premier à utiliser la méditation dans le cadre de ses entraînements. Invité par Allan Kaprow - lui aussi adepte de la méditation, pendant pratique de la philosophie boudhiste-zen -, il conçut un laboratoire expérimental dans lequel il œuvra à une discipline spirituelle et corporelle tout en écrivant de la poésie. Il proposa aux enseignants des écoles primaires, aux étudiants en pédagogie alternative et aux élèves qui participèrent à Other Ways d’aller sur les terrains de basket de l’école - dont dépendait le projet – pour y méditer à l’air libre et à la vue de tous. Aussi la pratique individuelle et recluse de la méditation devenait-elle un jeu tout aussi populaire et ludique que le basketball. Dans un second temps, toute l’équipe écrivit ce que Spino concevait comme de la poésie basketball tout en jouant en toute spiritualité au basket. Les poésies furent l’objet d’une édition dans la lignée du travail éditorial d’ Other Ways précédemment évoqué.
Moins connu mais tout aussi passionnant, l’architecte environnemental Sim van der Ryn proposa une classe gonflable qui occupa le local-vitrine d’ Other Ways Project. Assis en cercle sur des coussins à air, artistes, enseignants et étudiants de pédagogie radicale échangèrent sur des environnements favorables à l’apprentissage et à la participation des élèves dans la production de contenus. L’exposition Hippie Modernism: A Struggle for Utopia 38 a récemment rappelé combien Sim van der Ryn avait œuvré pour architecture qualifiée de modernisme hippie, c’est-à-dire porteuse d’une pensée éthique environnementale (sustainable), locale et collective selon le commissaire Andrew Blauvelt 39 . Lors de sa participation à Other Ways, l’architecte militant écologiste avait été la cible des forces de police. People’s Park, son projet collaboratif développé au sein de la Bay Area, avait été particulièrement visé. Il s’agissait de déployer un village écologique à partir des forces vives du Free Speech Movement qui s’étaient multipliaient sur le campus de l’université de Berkeley entre 1964 et 1965. Suite à l’interpellation par la police de l’étudiant Jack Weinberg engagé politiquement sur le campus, une foule d’étudiants bloquèrent la voiture des policiers pendant 32 heures et réclamèrent la liberté d’expression y compris pour les activités militantes à l’université. Le mouvement essaima ensuite de toutes parts et modifia la façon d’enseigner dans les universités. L’écologie était un des thèmes fondateurs qui figurait aux côtés des ambitions égalitaires prônées par le Students for a Democratic Society (SDS) ou celles du mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King et, ou encore s’associait au rejet de la guerre impérialiste menée contre le Viêt Nam. Tous ces courants de fond plaçaient Berkeley au cœur d’un contre-pouvoir. Berkeley constituait un centre de la contestation en opposition à Washington. Un nouvel État au cœur d’un État fédéral dans lequel l’écologie entendue dans sa relation à l’habitat et aux formes de vie de l’en-commun était tout aussi visionnaire que pragmatique. Dans ce sens, l’exposition au Walker Art Center associe les modernistes hippies de la Bay Area à une nouvelle forme de Commune et de communards pour qui l’architecture consistait moins en une obsession pour des formes plus ou moins rigoureuses qu’en un bricolage innervé par une pratique sociale et empirique d’un vivre-ensemble. Comme l’écrit Lorraine Wild, ces hippies communards étaient portés par « le rêve d’une utopie qui désignerait des espaces pour le bien commun et pour qui les codes esthétiques architecturaux seraient secondaires 40 ». Leurs méthodes, poursuit-elle, n’étaient pas particulièrement linéaires ou scolaires mais renvoyaient au langage de l’improvisation telle qu’on pouvait le retrouver ensuite dans la mécanique garage au sein de laquelle l’énergie prenait le pas sur le résultat.
Tout le système théorique de Buckminster Fuller était ici à l’œuvre et constituait une source infinie d’inspiration pour ce mouvement d’habitat écologique et durable. Son concept d’une design science revolution guidait les principes anti-capitalistes et anti-monumentaux de l’architecture. Á l’instar du dôme géodésique qui hébergeait un espace de vie commun au cœur du Musée Ford, et dont les étagères de la bibliothèque contenaient l’ouvrage de Fuller Operating Manual for Spaceship Earth, les discussions révolutionnaires dans la Bay Area côtoient la psychologie transpersonnelle, le mysticisme psychologique, la cybernétique et le bouddhisme zen. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans les archives de Kaprow relatives à cette période toute une importante documentation sur l’émergence d’une nouvelle révolution technologique, la cybernétique, associée à une expansion du monde, initiée par la colonisation de la Lune par les astronautes américains. Cette révolution terrestre impulse l’idée de développer un langage universel qui parlerait au-delà des limites de la Terre. On la retrouve incarnée par le Whole Earth Catalog édité entre 1968 et 1972. Comme beaucoup d’autres lecteurs, et notamment ceux intéressés par les différentes formes contre-culturelles, Kaprow avait été porté et inspiré par la couverture du premier numéro du Whole Earth Catalog. Celle-ci montrait la première prise de vue de la Terre depuis la Lune en 1966. Cette image iconique affichait une impertinente quête holistique dans laquelle la planète Terre devenait un symbole d’interdépendance, d’interconnexion en écho au Global Village de Marshall McLuhan, auteur important pour les acteurs de la contre-culture et pour Allan Kaprow qui le citait souvent. Resitué dans ce contexte, le Global Village de McLuhan n’incarne pas tant la vision prophétique du monde ultra-libéral à l’échelle d’internet que l’envie de préserver des enjeux sociétaux et environnementaux communs, intimant un courant écologique de sustainability, terme employé par Sim van der Rym au moment d’Other Ways. Cette vision contre-culturelle et ses usages modernistes hippies avait pour ambition de remettre en cause la répartition duelle d’un monde géopolitique marquée par la Guerre froide.

Six Ordinary Happenings
Entre le 7 mars et le 23 mai 1969, Allan Kaprow proposa Six Ordinary Happenings dans le downtown de Berkeley, tous inspirés par une nouvelle donne utopique et contestataire qui avait pris ses racines sur la côte Ouest. Cette série d’actions acheva la fin du programme Other Ways. Le premier happening, Charity consista à laver des vêtements usés et stockés dans des magasins de charité. Le second, Pose, proposa à ses participants (enseignants, étudiants, artistes et militants) de se munir d’une chaise, de parcourir la ville et de se prendre en photo avec des polaroïds tout en laissant derrière eux le portrait réalisé. Fine, le troisième, consista à se garer dans des zones prohibées, puis d’y attendre l’arrivée de la police afin de se voir gratifié d’une amende, de faire une photo de cette amende accompagnée de sa propre déclaration sur les faits et d’un paiement de l’amende, puis de retourner cette documentation de l’action à la police. Shape, le quatrième, consista à laisser des traces de sa silhouette détournée au spray au cœur de l’espace urbain. Give Away Dishes, l’avant-dernier, demanda de laisser des montagnes de vaisselles sales dans des recoins oubliés de la ville - comme des cabines téléphoniques - et de les photographier. Le dernier des Six Ordinary Happenings, Purpose, recommanda de réaliser des petites montagnes de sable et d’épuiser ce dernier en défaisant, déplaçant et rebâtissant ces tas éphémères.
Ces Six Ordinary Happenings étaient moins théâtraux que les précédents comme par exemple Course (1969) qui reposait sur une chaîne humaine et instauraient une rupture importante dans la conception de l’action et de la participation selon Allan Kaprow. En effet, il ne s’agissait plus d’un événement comprenant une masse anonyme de personnes mais d’une micro-action publique composée de personnes identifiées qui saisissaient et adhéraient complètement à la portée idéaliste de leur geste collaboratif. À ce moment-là, Kaprow devenait « un stratège alogique, ne stoppant plus l’action délibérément, la laissant achever sa course imprédictible, observant là où elle se rend. C’est à ce moment-là que Kaprow nomme ce qu’il fait un un-art 41 . » C’est alors que s’annonce le processus de un-arting un mouvement plus large que celui de la pédagogie radicale qui s’attèle à la déprofessionnalisation des arts.
La fin du printemps 1969 symbolisa l’acmé de la Révolution contre-culturelle aux États-Unis et, plus tristement, le terme de l’expérience Other Ways. Allan Kaprow et Herbert Khol divergèrent assez violemment sur la ligne à tenir. Herbert Khol penchait davantage vers l’action directe pour conduire une révolution sans précédent des institutions, là où Allan Kaprow se méfiait d’une véhémence peu spirituellement zen. Le creuset de leurs différents allaient nourrir la rédaction des trois essais The Education of the Un-Artist, pierre angulaire d’une œuvre qui allait de plus en plus se départir des précédents happenings pour le bénéfice des nombreuses activities. Le campus de CalArts allait devenir le théâtre historique de ce grand changement.
Woman’s Building – Woman Graphic Center – Sheila Levrant de Bretteville
Notes à partir de l’article de Izzy Berenson et Sarah Honeth : https://walkerart.org/magazine/clearing-the-haze-prologue-to-postmodern-graphic-design-education-through-sheila-de-bretteville-2
A l’automne 1969, Sheila de Bretteville revient aux USA après avoir travaillé en Italie dans le studio de Design d’Olivetti. Elle s’installe à LA avec les designers Robert Mangurian et Craig Hodgetts. Peu de temps après que Hodgetts soit nommé en tant que co-directeur de la School of Design at CalArts, la conception d’un certain nombre d’impressions (en-tête à lettre, poster par exemple) est commandé à SB pour attirer les étudiants dans la nouvelle école flambant neuve de CalArts. Dans la foulée, elle suit la publication en tant qu’éditrice et graphiste de l’ouvrage, Arts in Society: California Institute of the Arts: Prologue to a Community 42 (1970).
La School of Design cherchaient alors des étudiants avec « des besoins en écologie, technologie et humanité » car le goût et le style ne sont pas suffisants, revendique SB.
Forte de ses réalisations, SB rejoint l’équipe des enseignants. N’ayant pas d’expérience en tant qu’enseignante, SB propose une auto-analyse de sa formation en guise de lettre de motivation. Elle l’a met en perspective au regard d’évènements politiques qui ont compté à ses yeux (le mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King, les protestations pour l’arrêt de la Guerre du Viêt Nam et le retrait des troupes américaines, l’assassinat de Kennedy) et en écho avec son implication dans le mouvement de liberté de la presse et la conception de panneaux pour la télé représentant les idéaux du parti communiste italien.
En Italie, SB a lu Paulo Freire, elle est convaincue que l’enseignement peut être horizontal. Elle recherche les meilleures façons de concevoir des exercices, devoirs, commandes… qui puissent capitaliser à partir des différentes expériences, savoirs et compétences de chaque étudiant du département. SB offre une synthèse entre son éducation moderniste/bauhaussienne telle que l’université de Yale lui a transmise et une conscience critique d’un monde en profonde mutation. Sa devise est d’incarner “the sexploration of visual phenomena.” 7
in Italy in the late 1960s, in particular her engagement with the radical Italian design group Superstudio and architect Giancarlo de Carlo. Just as her lectures and essays eschewed “simplicity, clarity, and oversimplification,” de Bretteville’s designs embraced visual unruliness, employed a freewheeling juxtaposition of image and text, and adopted a multiple-author mode of production—an approach which allowed for as many different voices and competing aesthetics as possible.
Elle enseigne le graphisme avec des enseignants photographes et un dramaturge. L’enjeu est de développer une pédagogie de l’“object project”, c’est-à-dire une pédagogie qui développe une hyper acuité lors des choix visuels afin de répondre, restituer de la manière la plus éthique, « tolérante » (Paulo Freire) qui soit la voix de celle ou celui qui s’exprime. Cette pédagogie simple dans son protocole demande, par exemple, à chaque participant d’apporter un objet, de le décrire le plus factuellement possible et d’en produire une forme éditoriale. De cette façon, SB propose aux étudiants de partir indirectement de leur propre personnalité.
En 1971, SB dirige tout un département de lithographie, de gravure mais aussi d’imprimante offset et de presse linotype. L’été, on lui demande de concevoir le graphisme de Everywoman newspaper, un journal collectif initié par le Fresno Feminist Program. Le format se veut à l’image du protocole du groupe qui repose sur l’usage du Consciousness-Raising (C-R), groupe de parole qui assure une expression dans le temps et les contenus équitables des différentes voix . Chaque contributrice (enseignantes ou étudiantes) dispose d’une double page, fenêtre entière d’expression. Pour ce groupe séparatiste qui cherchait à son tour à produire une contre-culture, l’enjeu était de contrer l’organisation patriarcale en déconstruisant la hiérarchie.
Persuadée que la Révolution contre-culturelle passe par la mise en place d’un féminisme graphique et d’un graphisme féministe, elle met en place au sein de CalArts le Women’s Design Program (1971-1973). L’orientation du programme est par la suite publiée dans un numéro de la revue britannique Icographic . Un des essais de SB publié analyse la séparation rigide entre hommes et femme dans l’atelier. Dans un autre de ses essais, “Some Aspects of Design from the Perspective of a Woman Designer”, elle appelle les graphistes à légitimer ce qui a été minoré par les qualifications de valeurs féminines dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes.
Sa réalisation pour le catalogue de l’exposition Womanhouse, une maison de 17 pièces occupée par le Feminist Art program de novembre 1971 à février 1972, va dans ce sens. En réalisant une série d’installations spécifiques pour un site et de conférences-performances qui explore la relation structurelle et physique de la maison sur un certain nombre de rituels domestiques comme : cuisiner, laver, éduquer etc… Schapiro, Chicago, de Bretteville et leurs étudiantes ont démontré qu’à travers le processus de réhabilitation d’une maison abandonnée, on pouvait tout à fait transformer une situation prescrite et historique d’un espace domestique en un site de production esthétique analysée et conceptualisée . Une expérience qui prolonge la position de Paulo Freire dans la Pédagogie de l’opprimé.e. Les choix graphiques de Sheila de Bretteville sur la couverture du catalogue de Womanhouse , par exemple, viennent du lexique graphique expérimental, de l’architecture radicale et de la photographie conceptuelle.
Le Women’s Design Program et le Feminist Art Program dirigé par Miriam Shapiro et Judy Chicago fonctionnent en complémentarité jusqu’à ce qu’elles quittent CalArts en 1972 et fondent avec la complicité d’Arlen Raven le Feminist Studio Workshop (FSW) : la première école indépendante pour les artistes femmes qui préfigure le Woman’s Building à Downtown, Los Angeles (1973-1985). En partie un centre communautaire, en partie une école d’art et de design, l’artist-run space de LA héberge une variété de galeries d’art, d’ateliers, de maison d’édition et d’organisations militantes pendant ses 20 ans d’existence. Il est à la fois un lieu pour l’éducation artistique, l’organisation de la communauté féministe et plus généralement une pépinière pour développer un réseau de projets et de lieux féministes engagés autant dans la culture que dans la transformation sociétale. Depuis ses débuts, le Woman’s Building accueillent les premières conférences d’histoire de l’art féministes et produisent les premières vidéos et performances d’artistes. Le Woman’s Building est envisagé selon des principes d’auto-gestion qui proviennent de la pédagogie de l’opprimé.e, du Free Speech Movement et du Women’s Liberation. Il encourage la capacité de chacune à être à la fois artiste et son propre producteur/diffuseur : en cela la performance et l’édition jouent un rôle important d’encapacitation (empowerment) ou d’émancipation. Tout en étant impliquée dans la gouvernance du lieux, Sheila de Bretteville enseigne et organise des conférences sur le graphisme, le design environnemental. Elle affirme et développe sa pédagogie conçue et pratiquée depuis une approche du groupe. C’est-à-dire une certaine approche marxiste qui placerait le graphisme au cœur d’un projet égalitaire et une recherche efficace du changement social : The process by which forms are made and the forms themselves embody values and standards or behavior that affect large numbers of people…. For me, it is this integral relationship between individual creativity and social responsibility that draws me to the design arts. 22
Notes.
Sheila wrote a number of compelling articles on woman’s rights and space often ending up in feminists publications published through the Woman’s Building such as Chrysalis, a magazine of women’s culture, a contribution to culture, media studies, and women’s studies before there were courses in women’s studies in colleges and universities.
Projects at the WGC focused on typography, printing, and criticality within the social sphere. The wooden typeface Kabel was discovered as a part of the building’s past and was used for the Woman’s Building entry signage. Traditional fine art printing (such as etching and lithography) were not included due to limited resources and space. Their focus was on self-publishing in the form of letterpress-printed, offset-printed and silkscreen-printed posters, postcards, broadsides, artist books, 23 poetry chapbooks, stationary, and other kinds of small-press endeavors. 24 Sheila again brought back “the object project” in a Feeling to Form class taught with social psychologist Jane Stewart, urging students to find suitable forms from which women could derive content as a way of upending Modernist precepts of form as content. 25 Feeling to Form, then, was a literal reversal, extracting form from content, rather than content from form. This class arguably produced the most highly realized art at the Building, often in graphic form.
The art of the Woman’s Building sought action in addition to expression. Some of the best-known performance work was also the culmination of Sheila’s graphic design pedagogy. In particular, Leslie Labowitz’s and Lacy’s Three Weeks in May (1977), which updated a map with reports from the L.A.P.D., printing the word, “rape” on spots on a map of greater L.A., generated large-scale public awareness and media attention. The event combined a performance piece on the steps of L.A. City Hall with self-defense classes for women in an attempt to highlight sexual violence against women. As WGC student Emily King said, “printing gave work power and distance.” 26
Sheila’s format of direct address in public spaces, offered an original and persuasive lesson in feminist pedagogy, personal growth, and the search for authentic forms. In this vein, Sheila developed and taught the class, Public Announcements/Private Conversations (1975), which then became a series of site-specific art projects produced from 1977 to 1978 in which participants were asked to “write, design, print, post their posters, negotiate with the owners of the public places, and collect responses about and for places in the shared environment… Within this theme each woman gives graphic form to her concerns, placing this work—and thus placing herself—in public view.” 27 The project could then be tailored to each students needs and support the individual to find her own personal material and forms to express in. Through this class and others, form became a transformative experience, resulting in the perception of personal wholeness and collective unity at the Woman’s Building.
L’année précédente, j’avais animé un séminaire dans le cadre du Women’s Design Program mis en place au CalArts. Et pour ma conférence dans un amphithéâtre de Pasadena, j’avais choisi des images de mon travail illustrant ma volonté de combler l’écart entre les sphères publique et privée décrit par Virginia Woolf : « Devant nous, il y a la vie publique, l’univers professionnel, avec leur possessivité, leurs jalousies, leur pugnacité, leur cupidité. [...] La question que nous vous posons, c’est : comment accéder aux métiers tout en restant des êtres humains civilisés ? » Avec les étudiantes de mon séminaire, nous avions examiné les œuvres graphiques, utopiques et dystopiques, de Superstudio, et lu des textes de Catherine Beecher Stowe, Eva Figes, Germaine Greer, Shulamith Firestone et Betty Friedan. C’étaient ceux de Betty Friedan qui me causaient le plus de difficulté, parce que je viens d’une famille où les femmes travaillent depuis plusieurs générations, que ce soit dans des villes comme New York ou en Pologne. J’ignorais tout de la banlieue et de la vie qu’y mènent les femmes au foyer.
Sheila Levrant de Bretteville received her BA in art history from Barnard College in 1962 and her MFA in graphic design from Yale University in 1964; she also holds honorary degrees from the California College of Arts and Crafts and Moore College of Art and Design. She relocated to Los Angeles in the late 1960s, a move that would have a significant impact on her career both as an artist and as an educator. In 1971, at the California Institute of the Arts, she created the first women's design program. She performed many collective pieces with this group, including Menstruation (1972), which consists of several videos documenting group discussions about a topic still considered taboo at the time. In these videos, men and women ranging in age from adolescence to menopause delve into the cultural meanings and traditional conceptions surrounding menstruation. The work triggered de Bretteville's lifelong interest in communal forms of art, which she advocated as an essential component of the feminist art movement. In 1973 she founded the Woman's Building and the related Women's Graphic Center in Los Angeles. Also in that year, de Bretteville was a founding member of the first independent feminist art school in the United States: the Feminist Studio Workshop in Los Angeles.
Through her work in the feminist art movement in Los Angeles in the early 1970s de Bretteville met Betye Saar, an artist who had been deeply involved in the Black Arts Movement and feminist issues since the 1960s. The two would collaborate on projects throughout their careers. De Bretteville featured Saar's work on the cover of Chrysalis, no. 4, a feminist journal that she published through the Women's Graphic Center. She also designed exhibition catalogues for Saar: one for her 1984 solo show at Los Angeles Museum of Contemporary Art, and another for the 1990 two-person exhibition with her daughter Alison Saar at the Wight Art Gallery (now the Hammer Museum). In 1989–90 de Bretteville collaborated with Betye Saar, among other artists, on Biddy Mason: Time and Place, an 82-foot-long public mural project in Los Angeles commemorating the midwife and influential matriarch in the black community who lived at the site in the mid-nineteenth century. Public artworks have remained an important component of de Bretteville's practice, including Path of Stars in New Haven (1994); Omoide no Shotokyo in Los Angeles (1995); Search: Literature in Flushing, New York (1998); At the start … At long last in New York City's Inwood "A" train station (2000); and step(pe) in Yekaterinburg, Russia (2006).
-
Paulo Freire, La pédagogie des opprimés (1969), traduit du brésilien par Jean-Claude Régnier, Maspero, 1973, p.185. ↩
-
Sur le plan philosophique, Paulo Freire est inspiré par la phénoménologie, l’existentialisme, le personnalisme chrétien et le marxisme humaniste. Au début des années soixante, divers mouvements d'éducation populaire ont étés créés au Brésil, parmi lesquels : le Mouvement de Culture Populaire (MCP) en mai 1960 ; la Campagne « Les pieds nus apprennent aussi à lire » à Natal (Brésil) en février 1961 ; et le Mouvement d'Éducation de Base (MEB) en mars 1961. ↩
-
Nous citons les expressions terminologiques de Freire entre guillemets. ↩
-
Cf. Jean-Paul Sartre, « Préface » du livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961), La découverte, 2002 pour l’édition présente. « [Le colon] néglige la mémoire humaine, les souvenirs ineffaçables ; et puis, surtout, il y a ceci qu’il n’a peut- être jamais su : nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu’on a fait de nous. Trois générations ? Dès la seconde, à peine ouvraient-ils les yeux, les fils ont vu battre leurs pères. Mais ces agressions sans cesse renouvelées, loin de les porter à se soumettre, les jettent dans une contradiction insupportable dont l’Européen, tôt ou tard, fera les frais. Après cela, qu’on les dresse à leur tour, qu’on leur aprenne la honte, la douleur et la faim : on ne suscitera dans leurs corps qu’une rage volcanique dont la puissance est égale à celle de la pression qui s’exerce sur eux. » Jean-Paul Sartre, « Préface », in Frantz Fanon Les Damnés de la terre, op. cit., p.26. ↩
-
Valérie Solanas, SCUM Manifesto, Association pour tailler les hommes en pièce, (1968), Maspero, 1971. ↩
-
Paulo Freire, La pédagogie des opprimés, op. cit., p.22. ↩
-
Ibid., p.61. ↩
-
Ibid., p.28. ↩
-
Ibid., p.63. ↩
-
Ibid., p.92-93. ↩
-
Cf. Géraldine Gourbe, « Savoir et devenir pédagogique de l’émancipation, afro/féminisme et afro/marxisme », revue Initiales n°10 dédié à Maria Montessouri, septembre 2017 ↩
-
Ibid., p.64. ↩
-
Theodore Roszak, The Making of Counter Culture, Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, Oakland, University of California Press,1968-1995. ↩
-
Archives personnelles d’Allan Kaprow, Getty Research, Los Angeles. ↩
-
Ibid. Je souligne. ↩
-
Jeff Kelley, Childsplay: The Art of Allan Kaprow, University of California Press, Los Angeles, 2004, p.142. ↩
-
John Dewey cité par Jeff Kelley, op. cit., p.142. ↩
-
Interview non-publiée, réalisée par la critique et féministe Moira Roth à Passadena en 1973 et conservée dans les archives personnelles de Kaprow au Getty Research. ↩
-
Concept qu'il développe dans sa série de 3 textes de 1968 à 1973 The Education of the un-artist. ↩
-
Interview non-publiée, réalisée par la critique et féministe Moira Roth, Ibid. ↩
-
Ibid. ↩
-
Jeff Kelley citant Allan Kaprow, Ibid., p.158 ↩
-
Margaret Mahoney de Carnegie lui propose une bourse pour une expérimentation pédagogique et lui impose Allan Kaprow pour concevoir et accompagner un programme de formation des instituteurs. Cf. Herbert Khol The Discipline of Hope, Learning from a Lifetime of Teaching, New Press, New York, 1998. ↩
-
Cf. Géraldine Gourbe, In The Canyon, Revise The Canon, Savoir utopique, pédagogie radicale et artist-run community art place space, Rennes, ESAAA/Shelter Press, 2015. ↩
-
Jeff Kelley, Ibid., p.143. ↩
-
Herbert Khol, The Discipline of Hope, op. cit., p.275. ↩
-
Ibid. ↩
-
Ibid. ↩
-
Paolo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, François Maspero, 1974. ↩
-
Noah Purifoy est le commissaire d'une des premières expositions, en 1967, sur le Junk Art qui avait réunit entre autres des black artists comme Bettie Saar et Purifoy lui-même. ↩
-
http://history.berkeley.edu/sites/default/files/Learning%20from%20Watts%20Towers.pdf ↩
-
Allan Kaprow « Sucess or Failure When Art Changes » in Suzanne Lacy, Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Seattle, Bay Area Press, 1995, p.154-160. ↩
-
Allan Kaprow nommait pudiquement l’insulte « Fuck ». ↩
-
Cf. Judith Delfiner, Double-Barrelled Gun – Dada aux Etats-Unis (1945-1957), Dijon, Presses du réel, 2011. ↩
-
Cf. Maxime Cervulle, « Penser la blanchitude. Dynamiques épistémologiques » in Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, Paris, Amsterdam, 2013, p. 47-74. ↩
-
Jeff Kelley, Ibid., p.155. ↩
-
Allen Ginsberg depuis San Francisco a été un des membres fondateurs de la Beat Generation. Cf. Philippe-Alain Michaud, Beat Generation, New York, San Francisco, Paris, Centre Pompidou, 2016. ↩
-
Hippie Modernism: A Struggle for Utopia, Minneapolis, Walker Art Center, 2015. ↩
-
Cf. Andrew Blauvelt, « Hippie Modernism: Aesthetic Radicalism and Counterculture » in Hippie Modernism: A Struggle for Utopia, op. cit., http://www.walkerart.org/feature/2015/aesthetic-radicalism-counterculture ↩
-
Lorraine Wild cité par Andrew Blauvelt, Ibid. ↩
-
Jeff Kelley, Ibid., p.145. ↩
-
Arts in Society: California Institute of the Arts: prologue to a community, Volume 7, Issue 3, 1970. ↩